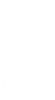L’Église catholique romaine pratique, depuis la fin du Moyen Age, sept rites sacrés qu’elle nomme sacrements. Avant cette époque certains théologiens en comptaient moins, jusqu’à trois seulement, d’autres davantage, jusqu’à une trentaine, y compris, par exemple, le sacre du roi chrétien et l’installation d’une abbesse à la tête d’une communauté de religieuses. Le premier rite qui fut désigné par le terme « sacramentum » était le Baptême, un rite que les disciples de Jésus ont hérité des Juifs, un rite d’initiation et de purification conforme à la loi mosaïque. Il était pratiqué notamment pour recevoir dans leur communauté des païens convertis à la foi d’Israël, donc de prosélytes.
Dans les communautés des Esséniens, sorte de moines juifs installés aux bords de la Mer Morte, le baptême consistait dans des ablutions souvent répétées pour maintenir les membres de la communauté dans un état de pureté rituelle. Jean Baptiste a pu s’inspirer de cette pratique pour inviter tous les pécheurs israélites à se convertir afin d’échapper au jugement de Dieu qu’il jugeait imminent. Il le comparait à la hache que les bûcherons posent à la racine des arbres qu’ils veulent abattre. Et c’est l’immersion de ces pénitents dans l’eau du Jourdain qui devait être le signe rituel de cette conversion. Jésus lui-même a demandé à Jean, selon le témoignage de Matthieu, de le baptiser en se montrant ainsi solidaire avec les pécheurs, tout en évitant de mettre l’accent sur le caractère imminent et menaçant du jugement. Il demandait seulement l’accueil du règne de Dieu qu’il disait proche. Après l’événement pascal, les disciples du Ressuscité baptisaient les convertis à son Évangile au nom de Jésus. Bientôt ils le faisaient au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
La condition de recevoir ce rite devenu chrétien était, dès le début, la foi dans le Christ se concrétisant dans l’amour du prochain. Le baptisé ne recevait bien ce rite d’initiation qu’en s’engageant au service du Seigneur. Aussi Tertullien, un théologien laïc, a pu comparer le baptême au serment de fidélité que les soldats romains, engagés volontaires, prêtaient au moment de leur incorporation, un rite qui portait le nom de « sacramentum militare ». Le terme de sacrement a pris ainsi son origine. Il désignait, avant tout le Baptême, mais très tôt il fut appliqué également aussi au Repas du Seigneur, l’Eucharistie. Car l’Église naissante avait conscience d’entrer dans la mouvance de l’engagement salvifique de son Seigneur en rendant siens les deux gestes rituels que Jésus lui-même a accomplis par son Baptême dans les eaux du Jourdain et par son repas d’adieu convivial avec les Douze. Telle est la raison pour laquelle la tradition théologique a nommé le Baptême et l’Eucharistie sacrements « majeurs » ou « dominicaux », c’est-à-dire rattachés directement à une initiative du Seigneur.
Et les autres sacrements ? Ne sont-ils pas également « dominicaux », c’est-à-dire institués par le Seigneur ? La théologie actuelle ne parle plus d’institution au sens juridique. Car Jésus n’a ni rédigé ni signé de documents créant un rituel sacré, mais il a manifesté sa volonté de lier, par exemple le pardon divin, à une décision de ses disciples afin que ce qu’ils liaient ou déliaient sur terre soit également lié au délié au ciel. De même son attitude, par exemple, aux noces de Cana envers les mariés peut être considérée comme révélation et approbation de la bénédiction donnée à un couple qui s’engage à vivre ensemble selon la volonté de Dieu. Derrière l’onction des malades, il y a les nombreuses guérisons pratiquées par le Nazaréen. Jésus n’était donc pas créateur des rites nouveaux. Même pour le Baptême et la Cène, il a repris des rites juifs en se contentant de leur donner un sens nouveau. Il vaut donc mieux de ne pas insister sur une « institution » de nos sept sacrements par Lui. Par ailleurs, ceux-ci ont été développés au cours de l’auto-organisation de l’Église par sa propre pratique. Le rapport au Christ est donc essentiel aux sacrements quant à leur intention, mais non à leur modalité de célébration. Le Christ doit être vu plus comme Acteur que comme Inventeur de nos rites sacrés. C’est ce que voulait exprimer Saint Augustin en disant : « Que ce soit Pierre ou Paul, voire Judas qui baptise, en réalité c’est le Christ qui baptise ». Tout sacrement est un événement christocentrique. Il est proposé, donné, agi par le Christ. Il en est, selon la tradition, son « ministre principal » en faveur du croyant qui s’engage envers Lui. Il y a donc interaction, bien sûr asymétrique, entre le donateur et le récepteur.
Mais revenons à une question fondamentale : qu’est-ce qu’un rite ? C’est une activité par laquelle le vivant, tant animal qu’humain, exprime son identité par voie vocale ou gestuelle, ce qui correspond chez l’homme à sa constitution inséparablement corporelle-spirituelle. Cette activité a des formes en principe invariables et récurrentes. Elle est accomplie avant tout en référence aux moments fondamentaux de l’existence : naissance, maturité, intégration à la communauté porteuse, union conjugale, fin de vie. De tels rites marquaient chez l’homo sapiens ce qui constitue son humanité concrète, vécue, de sorte qu’une humanité dépourvue de rites est inconcevable.
Dans l’histoire de l’humanité ont existé et existent, à côté de rites sacrés, c’est-à-dire en rapport avec le divin, une multitude de rites de caractères profanes, et cela même dans les sociétés fortement sécularisées. Ils marquent dans pratiquement toutes les cultures, avant tout le commencement et la fin de vie individuelle, soit la naissance et la mort, donc les deux moments majeurs de l’existence. D’où la célébration de l’anniversaire et des funérailles où parfois même des athées aspergent le cercueil avec de l’eau bénite. Nos écoles ont le rituel pour récompenser les meilleurs élèves par une distribution de prix. Notre nation tient à se célébrer par le défilé du 14 juillet. Le rite de déboucher une bouteille de champagne marque toute entreprise réussie.
Je cite ici le théologien Bernard Sesboüé : « Le rite, même profane, transcende ma vie immédiate et temporelle. Il exprime une dimension de mon existence qui n’arrive pas à se dire en langage ordinaire. D’où une ouverture spontanée du rite à l’expression du sacré » (Croire, Paris 1999 p. 476).
Cela nous conduit à l’histoire des religions où le sacré se trouve identifié au divin. D’abord au divin d’une multitude de dieux et de déesses, ensuite au Dieu unique. Mais ce sacré apparait au niveau des cultes ambivalents. Ici on adore des êtres bienveillants et prévenants, là des puissances fascinantes et terrifiantes dont les adorateurs ont tout intérêt à gagner les faveurs en y mettant pour ainsi dire le prix. Alors les rites sont instrumentalisés à cet effet. On pratique la magie, où l’accomplissement du rite équivaut à tenter de prendre possession d’une puissance surnaturelle. Une tentative semblable a été identifiée par Martin Luther chez les « papistes » qui voulaient, à son avis, en multipliant les célébrations sacramentelles gagner leur salut. C’était oublier que la grâce salvifique ne peut être que don absolument gratuit de Dieu. Une telle perversion des rites sacrés a atteint, aux yeux des Réformateurs, son sommet dans la vente de lettres d’indulgence par le pape de l’époque pour financer la construction de la basilique Saint Pierre.
Une autre thèse de théologiens catholiques que rejetaient les Réformateurs consistait dans l’affirmation que la messe était un sacrifice que l’Église offre pour les vivants et les morts en complément du sacrifice de la croix, afin de contribuer à leur rédemption.
La première théorie systématique des sacrements chrétiens est due à Saint Augustin. Selon lui, adepte de la philosophie néoplatonicienne, un sacrement est un signe sensible, visible, audible, palpable, étroitement uni à une parole qui l’interprète et en indique le sens. Il sollicite avant tout un acte de connaissance et d’intelligence du croyant. Mais l’originalité d’Augustin consiste surtout à avoir mis cette définition en rapport avec le prologue de l’Évangile selon Saint Jean qui parle du Verbe incarné, celui qui était au commencement, par qui tout a été fait et qui s’est fait homme. La Parole divine est ainsi devenue une personne humaine en chair et en os, Jésus de Nazareth, pour être le signe de la grâce divine proposée et communiquée à tous les hommes. Voilà pourquoi Augustin considère le Christ comme le Sacrement par excellence de Dieu, son Sacrement en Personne. Cependant à ses yeux le Christ n’est pas seulement le modèle, mais aussi l’Acteur principal des rites sacrés chrétiens. Il écrit : « que ce soit Pierre ou Paul, voire Judas qui baptise, en réalité c’est le Christ qui baptise ». C’est Lui qui est le Ministre principal du Baptême et du Repas du Seigneur, des deux sacrements dont Augustin parle dans ses écrits. Aussi trouve-t-il logique que le prêtre célébrant le sacrifice eucharistique ne fasse que reprendre l’énoncé de Jésus sur le pain : « ceci est mon corps ». De toute évidence cet énoncé de Jésus est efficace puisqu’il est celui du Verbe incarné, mais aussi parce qu’il est celui du Messie dont le dire a été fréquemment en même temps un véritable faire. La même efficacité s’est manifestée lorsque le Nazaréen a dit au paralytique : « Lève-toi et marche » que lorsqu’il a déclaré : « ceci est mon corps ». Je me demande si nous ne pourrions pas faire intervenir ici le concept des « actes de langage » qui a été développé par le philosophe américain John Austin. Pour lui, il existe des dires qui sont en réalité des faires. Ce sont des paroles qui affectent les sujets envers lesquels elles sont prononcées, tant en bien qu’en mal, soit en les libérant, soit en les blessant. S’il en est ainsi, on pourrait peut-être dire que l’Evangile, la Bonne Nouvelle, est bien plus qu’une nouvelle puisqu’il a vocation d’être agi, réalisé, accompli.
Je ferme la parenthèse et je reviens à Saint Augustin. Je pense que la théorie des signes, à la fois parlant et agissant, reliée au thème johannique du Verbe incarné, peut nous aider même aujourd’hui à repenser nos sacrements dans des termes de communication et de rencontre entre Dieu et les hommes dans le Christ. Augustin interprétait le Baptême et l’Eucharistie en allant, pour ainsi dire, de haut en bas. Mais en mettant en même temps l’accent sur la foi-confiance sans laquelle les sacrements ne serviraient à rien et en s’accordant avec Tertullien pour qui tout sacrement est un acte d’engagement à la fois personnel et communautaire, il a posé des jalons pour une conception communicative des sacrements chrétiens. Mais, avant d’esquisser une telle théologie, je voudrais dire encore un mot sur Thomas d’Aquin qui a fortement influencé la doctrine catholique jusqu’au Concile Vatican II, pour le meilleur et aussi, indirectement, pour le pire. Le pire s’étant produit dans la rupture entre doctrine catholique et protestante des sacrements.
Tout comme Augustin, Thomas était aussi philosophe, mais moins influencé par Platon que par Aristote. De ce fait, il était plus préoccupé d’objectivité que de subjectivité. Les sacrements sont à ses yeux des réalités objectives composées de « matière et de forme ». En tant que tels ils fonctionnent comme causes instrumentales de la grâce dont Dieu est la cause première. Chaque rite sacré médiatise sa propre grâce qui est « infusée » au croyant qui peut aussi la perdre en commettant un péché grave. Il lui est également possible de la récupérer par ses mérites. Le théologien qui pense ainsi introduit dans sa théologie des catégories de la physique et du droit, même s’il le fait par analogie. Cela risque de l’éloigner d’une pensée relationnelle et préoccupée du comportement interpersonnel cher à Augustin. L’emploi de métaphores comme le canal qui conduit la grâce vers l’âme du fidèle ou le vase qui la contient afin de la lui infuser risque de chosifier ce qui est le don de soi gratuit de Dieu à ceux qui s’en remettent à Lui sans réserve, et de s’éloigner ainsi de la pensée biblique. J’évoque encore une expression de Thomas qui, mal comprise, a provoqué une rupture entre théologiens protestants et catholiques, l’expression selon laquelle un sacrement « opère » la grâce par le seul fait de son administration correcte, c’est-à-dire conforme à ce que veut l’Église, ne dépendant en rien de la qualité morale, de la dignité ou de l’indignité du ministre qui l’administre ou du chrétien qui la reçoit. Thomas lui-même voulait dire par sa formule que Dieu seul valorise l’action sacramentelle et non le mérite humain, ce qu’affirmaient aussi plus tard des Réformateurs. Les théologiens qui faisaient de cette expression un argument pour renforcer le pouvoir ecclésiastique sur le peuple fidèle, en tant que grand distributeur de grâces, ont perverti la pensée de Thomas.
Si je m’arrête à ces détails, c’est que dans les catéchismes qui avaient cours avant Vatican II, il ne manquait pas de traces de thomisme détourné qui empêchaient une compréhension correcte de la doctrine catholique des sacrements.
Tout ce que le Concile dit des sacrements est conditionné, plus ou moins explicitement, par sa conception de l’Église comme peuple de Dieu. Ce n’est certes pas un peuple au sens de la démocratie élective moderne. Le peuple de Dieu garde une structure hiérarchique, mais il lui assigne une fonction ministérielle ayant vocation d’agir au service de la communauté. La métaphore « berger-troupeau » se trouve sauvegardée. Ceux qui conduisent la communauté ecclésiale continuent à être appelés « père » et le premier d’entre eux « pape ». Mais ce schéma vertical trouve son contrepoids dans la structure horizontale des charismes que l’Esprit accorde à tous, ce qui conditionne aussi la pratique des sacrements. On comprend que le premier document du Concile fut consacré à la liturgie ayant pour principe fondamental la « participation active » de tous les fidèles. Les rites sacrés ne devaient plus se dérouler comme une action exclusive du clergé, reléguant les laïcs au niveau d’une pieuse passivité, mais comme un comportement coopératif faisant place à une certaine liberté d’initiative de chaque partie participante. Par ailleurs les pères conciliaires semblent avoir tenu compte des prières spontanées des protestants évangéliques qui ont un succès croissant auprès des chrétiens d’aujourd’hui. On pourrait penser que cette manière de prier correspond mieux aux besoins spirituels de nos contemporains que la répétition continuelle de formules toutes faites et datées d’époques révolues. Notons que le Concile attache une grande importance au chant et à la musique dans la participation active des croyants à la liturgie sacramentaire, notamment eucharistique. Mais ce faisant n’ouvre-t-il pas la voie à l’introduction de la danse dans les célébrations ? En pensant à Saint Augustin est-il interdit de penser que le Verbe incarné peut être glorifié aussi par l’harmonie de corps dansants ? Ce qui se pratique dans des communautés africaines permet de répondre négativement.
Le principe de participation active prôné par le Concile est lié à un autre principe, celui de l’apostolat des laïcs. Leur part active prise au culte communautaire, qu’on pourrait appeler une sorte de concélébration, a vocation de les préparer à leur activité missionnaire, ce qui n’est pas chose facile dans une société sécularisée et laïque. Pour être à la hauteur de ces tâches cultuelles et apostoliques inséparables de la pratique des sacrements Vatican II insiste sur la nécessité d’une formation continue. Clercs et laïcs y sont appelés. Cela soulève la question de formateurs et d’enseignants compétents. Le Concile en a été conscient mais, à mon avis, il n’a pas insisté suffisamment sur le besoin d’instruction catéchétique fondée sur les résultats de la recherche théologique en modernité. Il en résulte une inculture regrettable dans le domaine de l’intelligence de la foi, notamment dans les paroisses catholiques de France. J’y vois l’une des causes de la diminution de la pratique religieuse dans beaucoup de ces communautés qui s’accentue encore un demi-siècle après le Concile. Pour l’illustrer je vais citer un texte de Bernard Sesboüé tiré de son livre intitulé « Croire » paru en 1999 : « Reconnaissons que la compréhension des rites chrétiens est en crise aujourd’hui. En témoigne une prodigieuse diminution de la pratique chez les catholiques. Depuis longtemps déjà, celle du sacrement de réconciliation était en baisse constante. Les dernières décennies du XX siècle ont vu en France la diminution de la fréquentation de la messe dominicale (32% en 1946 ; 20% en 1970 ; 10% en 1990). Il en va de même du baptême (92% en 1961 ; 82% en 1963 ; estimation de 50% pour l’an 2000) et du mariage (227000 en 1979/…/137000 en 1992/…/. On sait aussi la grande raréfaction du nombre des ordinations presbytérales au cours de ce siècle (1500 par an en 1900 ; 130 depuis 1976) »
Nous ne pouvons pas éluder la question : Comment et pourquoi nous en sommes arrivés là ? Quelles sont les causes de cette désacramentalisation de nos communautés surtout chez les croyants désireux d’intelligence de leur foi ? Les conférences participatives sur le Baptême, le Repas du Seigneur, le sacrement de Réconciliation, l’Onction des malades, le Mariage et l’Ordre chercheront des éléments de réponse, entre autres à ces interrogations critiques. Ici je me contente de terminer par un vœu concernant les textes liturgiques toujours lus dans les célébrations de nos sacrements, ceux qui expriment de la violence religieuse. Bien qu’il ait été supprimé dans les supplications de la veillée pascale la prière pour les « juifs perfides », on y a gardé la jubilation sur la noyade des Égyptiens et de leurs chevaux dans la Mer Rouge. Dans d’autres textes liturgiques on parle encore de la malédiction des réprouvés et de leur plongée dans le feu éternel, etc. Lus sans interprétation adéquate, ces textes infestent inutilement la célébration de nos rites sacrés par des images tirées d’antiques mythes apocalyptiques.
Pour terminer, je voudrais dire que je vois, avec beaucoup de théologiens d’aujourd’hui, en tout sacrement, mais avant tout dans l’Eucharistie, une rencontre du Christ avec le croyant. Cela se manifeste au moment de la communion. Le prêtre dit en mettant l’hostie dans la main du communiant : « le corps du Christ » et le communiant répond « Amen » c’est-à-dire « Oui c’est vrai ». Car il croit que ce qu’il est entrain de recevoir est la personne vivante de Jésus Christ qui se rend présent à lui et qui vient à sa rencontre ici et maintenant, malgré son invisibilité et l’immense distance dans le temps et dans l’espace qui le sépare de Lui. Aussi cet « Amen » exprime-t-il que le croyant confiant s’en remet totalement au Christ présent et s’engage à son service. Le sacrement sert à réaliser la communion interpersonnelle entre le Christ et celle ou celui qui croit en Lui. Que ce moment de rencontre est essentiel aussi aux autres sacrements, je tâcherai de le montrer dans les conférences suivantes.