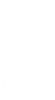<img8777|right>Ce titre se justifie par le contexte historique de la religion juive qui existait déjà plus d’un millénaire avant l’apparition du christianisme. Cette religion se singularisait parmi les autres religions du Moyen Orient de l’époque par son monothéisme radical, par sa foi en un Dieu unique. Et c’est dans cette foi qu’est né et a vécu Jésus de Nazareth. Le nom qui lui a été donné, en hébreu Jehoshuah est un prénom « théophore », c’est-à-dire porteur de Dieu, celui d’Israël qui se nomme Yahvé. Cela donne au prénom Yeho-shuah la signification « Yahvé sauve ». Ainsi Jésus porte, dès sa naissance, l’indication de sa vocation salutaire et salvifique. De plus, Jésus, le Juif, sera bientôt reconnu par ses disciples qui étaient en majorité des Juifs, comme le Messie qui devait venir pour sauver son peuple. Cette dénomination vient de l’hébreu Massiah qui veut dire « l’Oint », celui qui a reçu de Dieu l’onction en vue de promouvoir le salut du peuple élu. La traduction grecque de Massiah est Christos, d’où le mot français Christ et aussi le mot christianus, chrétien.
La judéité de Jésus se montre donc un facteur constitutif de l’origine du christianisme. Il ne faut pas oublier que Jésus lui-même a pris ses distances avec le judaïsme tel qu’il se pratiquait par beaucoup de ses coreligionnaires de son époque, notamment celui de l’oligarchie sacerdotale ainsi qu’une bonne partie des pharisiens. Nous y reviendrons plus loin.
Mais restons encore aux données linguistiques.
Quand nous chantons dans notre liturgie actuelle alléluia et hosanna, notre prière parle en hébreu. Hallelu veut dire louez, faites la louange, et Halléluia : louez Yahvé. Et quand dans la messe en latin nous chantons : Sanctus /…/ Dominus Deus Sabaoth, nous nous adressons au « Dieu des armées » et ce faisant, nous évoquons sans le savoir une vieille croyance juive selon laquelle Yahvé est un chef d’armées qui soutient les israéliens dans leur conquête de la terre promise. Plus pacifique est le cri de joie hosanna par lequel, selon M 11,9, la foule a salué Jésus entrant à Jérusalem sur le dos d’un modeste âne, avant sa passion. En ce qui concerne le mot hébreu amen, il se rapporte dans la bouche de Jésus à l’idée de la vérité, notamment à des énoncés ou des promesses qui se vérifieront sûrement, aussi, est-il juste de traduire par « en vérité, je vous le dis », avec la signification : ce que je vous dis, ce ne sont pas des mots en l’air.
Tous ces vestiges linguistiques, ou presque, témoignent de l’origine juive de la foi et de la spiritualité chrétienne. S’ajoutent encore des vestiges plus substantiels, par exemple celui de la prière Notre Père dont les premiers deux mots prononcés par les juifs devenus chrétiens étaient en hébreu en disant « Abinu » et dont chaque phrase a une correspondance dans la Bible juive. Il y a plus encore. Trois de nos sacrements rappellent également notre héritage religieux Judaïque.
L’Eucharistie, que nous appelons aujourd’hui à juste titre Le Repas du Seigneur, en est le premier. Les premiers chrétiens qui le célébraient ne le faisant pas seulement en mémoire du repas que Jésus avait pris avec ses douze Apôtres à la veille de sa passion, mais ils entraient aussi dans la mouvance des nombreuses communautés de table que Jésus a pratiquées avec des convives très divers pendant sa vie publique. Pensons seulement aux gens chez qui il s’est invité pour que son Évangile puisse les atteindre grâce à un repas commun. C’est une démarche bien juive. Notons que même l’accomplissement messianique devait se conformer à l’usage d’une communauté de table et que selon une tradition prophétique le Messie lui-même devait y faire le service de table aux invités. Semblablement, l’Alliance entre Israël et Yahvé devait être célébré par un repas sacrificiel, et la Nouvelle Alliance a suivi le même modèle.
Le sacrement du Baptême est également d’origine juive. Avant d’être pratiqué comme rite d’initiation chrétienne, il était administré à des païens convertis à la foi d’Israël. On l’appelait baptême des prosélytes.
Évoquons encore le rite d’ordination presbytérale. Quand les premiers chrétiens éprouvaient le besoin d’être dirigés par des ministres élus par leurs communautés, ils ont choisi comme modèle les collèges « d’anciens » des communautés juives. C’étaient des laïcs et non des lévites, membres de la tribu sacerdotale, officiant au Temple de Jérusalem. Ces « anciens », appelés en grec presbyteroï recevaient une ordination par l’imposition des mains du collège presbytéral qui les avait cooptés.
Après la présentation des vestiges linguistiques, rituels et spirituels d’un judaïsme qui est à l’origine du christianisme, il nous faut tenir compte du facteur différence, car tout ce qui est véhiculé par la tradition juive qui est bien multiforme, ne peut pas être considéré comme préfiguration ou anticipation du christianisme.
Deux courants caractérisent le judaïsme pré-chrétien: un universaliste et un particulariste. On pourrait dire, que le judaïsme universaliste est recevable et doit être reçu comme origine, voire élément constitutif du christianisme authentique, tandis que le judaïsme particulariste ne l’est pas. Si l’on demande où se trouve le premier et le second, on répondra : les deux se trouvent déjà bibliquement attestés. Le premier livre de la Bible juive, la Genèse parle de la création de l’Univers sans parler d’Israël. Abraham est présenté à la fois comme l’Ancêtre des juifs et père des nations. La terre est d’abord nommée adamah, qui est habité d’adam, c’est-à-dire de l’humanité toute entière, avant d’être nommé aretz, la terre qui est promise au peuple élu. Ce territoire sera considéré par les juifs orthodoxes de tous les temps comme leur propriété exclusive, de sorte que les juifs, ayant expulsé les autochtones palestiniens, ont le droit de les coloniser. C’est bien un judaïsme particulariste voire nationaliste qui les y autorise.
Qu’est-ce qui est universel ? On peut dire que c’est la qualité d’une unité – objet ou sujet – qui est dans son être même tourné vers l’ensemble d’autres que soi et capable d’entrer en relation avec cet ensemble. Ainsi se révèle déjà selon la Bible, le Créateur du monde comme l’être universel par excellence. L’être humain est également universel en tant l’image de Dieu, mais aussi en tant que créé homme et femme. Pour cette raison, si l’homme masculin se croit seule image de Dieu en oubliant la part féminine de l’humanité, il manque à sa vocation d’universalité. Un texte biblique qui est fortement marqué de cette déviation est 1 Tim 2. 11-13 qui impose le silence à la femme pendant l’assemblée liturgique avec l’argument qu’Adam avait été créé en premier et Ève seulement en second. Le machisme des rabbins juifs du temps de Jésus est également connu : ils s’interdisaient de prendre des disciples féminins. Le Nazaréen a rompu avec cet usage.
Il ne semble pas impossible que Jésus ait émancipé la femme sous l’influence de ce rare bijou de la Bible juive que l’on trouve en Proverbes 8, 22-34, qui présente la Sagesse personnifiée de Dieu, non seulement comme fille chérie de Dieu, mais aussi comme le maître d’œuvre de sa création tout entière. C’est un personnage de caractère évidemment universel, puis que par sa nature même, tourné vers l’ensemble des créatures.
Que la différence de genre ne justifie pas la subordination de la femme a Paul, l’homme l’ex-pharisien, donc ex-particulariste juif, devenu apôtre de Christ, ait pu avoir quelque difficulté à comprendre explique qu’il a pu avoir des « machistes » parmi ses disciples.
Le judaïsme particulariste se montrait et se montre encore coriace. Dans la Bible juive le livre de Josué présente une image agressive du peuple élu, de même de la manière violente dont il aurait été autorisé par son Dieu à conquérir la terre qui n’était pas la sienne, mais qui lui aurait été promise. C’est une idéologie que les israéliens colonisateurs de nos jours reprennent à leur compte en ce qui concerne les territoires palestiniens. Dire cela ne signifie aucunement que l’on ignore le danger mortel que représente pour la survie de l’État d’Israël un particularisme islamiste et que l’on ne puisse pas comprendre que certains juifs puissent considérer cette politique comme légitime défense et comme moyen d’éviter une nouvelle Shoah.
Mais revenons au judaïsme du premier siècle de notre ère.
La religion dans laquelle le jeune Jésus fut élevé était une religion d’observances. Il s’agissait d’observer les nombreux commandements que Yahvé donnait à Moïse de fixer par écrit, sous la forme des Dix commandements. Ne pas faire ce que Yahvé a exigé de faire signifiait pécher contre Dieu et contracter une souillure morale dont il fallait se purifier sous peine d’être jugé et châtié. Jean Baptiste a comparé ce châtiment à un coupe de hache qui est donné aux racines d’un arbre qu’on abat pour n’avoir pas porté de fruits. Comme Jean était un juif apocalyptique, sa menace des pécheurs revêtait le caractère d’un ultimatum. Comment a réagi Jésus au judaïsme sévère de son ami ? D’une façon surprenante, il s’est mis au rang des pécheurs en demandant à Jean de lui administrer son baptême pour la rémission des péchés, soit des non-observances de la Loi. Puis il est parti pour le Galilée annoncer non pas le jugement divin, mais l’Évangile, soit la bonne nouvelle de l’arrivée du règne miséricordieux de Dieu.
Plus tard, il a marqué aussi sa différence par ses fameuses antithèses rapportées par Mt 5. Il y cite les commandements de la Loi mosaïque, puis il en donne sa propre interprétation en disant : « et moi, je vous le dis ». Veut-il, par-là, supprimer la Loi de Moïse et la remplacer par la sienne ? Pas du tout. Il affirme : je ne suis pas venu abolir mais accomplir la Loi.
Accomplir par voie d’intériorisation, par exemple en prévenant un acte d’adultère, en contrant déjà son projet, son intention. Il procède aussi par radicalisation, par exemple en insistant sur l’amour du prochain au lieu de suivre le traditionnel « œil pour œil, dent pour dent ». Jésus marque aussi sa différence en ce qui concerne le repos sabbatique. Il ne permet pas seulement de nourrir un affamé le jour sacré, mais il en fait un devoir. Nous pouvons conclure : Jésus n’hésite pas à réformer l’observance de la Loi juive en mettant l’accent davantage sur son esprit que sur sa lettre.
En faisant de ‘l’amour du prochain’ le plus haut commandement dont la portée dépasse toutes les exigences particulières et codifiables de la Loi mosaïque, il donne libre cours à une spiritualité inventive, créative car attentive aux besoins concrets des personnes à aimer.
Avant de commenter la passion et la crucifixion de Jésus, ce drame révoltant auquel devait aboutir le clivage entre son judaïsme de caractère universel et le pouvoir sacerdotal établi de son pays, il nous faut parler du rôle décisif qu’a joué l’Apôtre Paul dans l’origine du Christianisme. Dans la première moitié de sa vie, Paul était un pharisien, donc un représentant zélé d’un judaïsme très particulariste qui donnait une interprétation rigoriste de la Loi et de son accomplissement. Il attendait le salut en tant que la récompense méritée par son observance sans faille. En Jésus et ses disciples, il voyait des hérétiques qu’il se croyait obligé de persécuter. Mais sa rencontre avec le Christ ressuscité l’a complètement retourné, jusqu’à faire de lui, le juif convaincu de l’absolue supériorité de sa religion, l’Apôtre chrétien des païens. Il alla même plus loin. Converti à la foi en Christ, il cessa de voir dans la Loi mosaïque la source principale du salut. Certes Paul reconnaît désormais le mérite de la Loi d’avoir mis en évidence ce qui est contraire à la volonté divine. Mais d’autre part il lui reproche d’avoir été incapable de susciter chez ses observants la certitude du salut. Comment pourrait-il le faire, quand on sait que le salut est don gratuit de Dieu miséricordieux et non quelque chose que l’homme est capable de mériter.
Se joint à cette critique la conviction que le don gratuit du salut en Christ n’est pas réservé au peuple élu et que les chrétiens venus du paganisme ne sont pas tenus à se faire circonscrire avant d’être baptisés. En résumé, l’œuvre théologique de l’Apôtre Paul a permis un retour par voie d’interprétation à l’universalisme des grands prophètes d’Israël, un judaïsme qui a pu devenir un élément fondateur de l’universalisme chrétien. Être catholique, c’est être foncièrement universel, c’est-à-dire constituer une unité ouverte à toute l’humanité. Mais, pour Paul, le point de départ de cette unité ouverte reste de façon inaltérable, bel et bien juif. Malgré le drame de la crucifixion, Israël, pour lui, reste le peuple élu. Car Dieu est fidèle donc Il tient ses promesses. Il est par conséquent juste de parler même en théologie de judéo-christianisme.
Depuis Vatican II on peut affirmer cela sans problèmes. Avant, les relations entre les deux religions étaient conditionnées par une tendance plus ou moins latente à l’antijudaïsme des chrétiens et de l’antichristianisme de beaucoup de juifs. Le point de rupture se situait dans le drame et l’interprétation de la crucifixion de Jésus.
Pour la recherche historique il est établi que ce qu’on appelle le « procès de Jésus » était dépourvu de tout souci d’objectivité et de justice, ressemblant plus à ce que font subir les régimes totalitaires à leurs accusés.
Le récit de Mt 27, 20-26 donne une réponse qui semble autoriser les chrétiens de rendre l’ensemble des juifs collectivement responsables de l’exécution de Jésus. Il y est relaté, que le procureur romain, Pilate, mis sous pression par les grands prêtres et les anciens juifs de Jérusalem, pour qu’il fasse exécuter Jésus. Pilate sait que leur réponse est motivée par pure jalousie et que même son épouse pense que Jésus est un juste, injustement accusé. Quand un groupe de partisans de l’oligarchie sacerdotale arrive en réclamant que Jésus soit crucifié, Pilate leur cède tout en disant qu’il n’est pas responsable de cette condamnation : il s’en lave les mains. D’un autre côté, les partisans des grand prêtres (Mathieu parle d’une « foule ») rassurent Pilate « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ». L’évangéliste ajoute encore : « et tout le peuple répondit ». Ce texte a fait histoire, car des générations de chrétiens l’utilisaient comme preuve de la responsabilité du peuple juif pour la crucifixion du Christ.
Il a fallu près de vingt siècles pour que l’absurdité de cette accusation soit reconnue par le Magistère de l’Église catholique. Cette reconnaissance est probablement due en partie à Jules Isaac, un historien juif français, qui, après avoir publié son ouvrage Jésus et Israël (Paris, 1948), est entré en contact avec deux cardinaux, Roncalli – le futur Jean XXIII – et Bea, un éminent exégète. Isaac a prouvé qu’il est exégétiquement impossible de déduire de Mt 27,26 l’historicité de la phrase : « son sang est sur nous et sur nos enfants » la responsabilité de tout le peuple juif pour la crucifixion de Jésus.
Roncalli et Bea, à leur tour, ont influencé le Concile Vatican II, pour qu’il prenne position. Le Concile l’a fait dans son document Nostra Aetate, en se gardant de se limiter au seul problème de la crucifixion, mais en parlant d’abord de tout ce qui constitue le patrimoine commun des juifs et des chrétiens.
Nous citons l’ensemble du document :
« Scrutant le mystère de l’Église, le saint Concile se souvient du lien par lequel le peuple du Nouveau Testament est relié spirituellement à la lignée d’Abraham.
En effet, l’Église du Christ reconnaît que les débuts de sa foi et de son élection se trouvent déjà chez les patriarches, Moïse et les prophètes, selon le mystère divin du salut. Elle confesse, que tous les fidèles du Christ, fils d’Abraham selon la foi, sont inclus dans la vocation de ce patriarche, et que le salut de l’Église est symboliquement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. C’est pourquoi l’Église ne peut oublier qu’elle a reçu la révélation de l’Ancien Testament par l’intermédiaire de ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde ineffable, a daigné conclure l’antique Alliance, et qu’elle se nourrit de l’olivier franc sur lequel ont été greffés les rameaux de l’olivier sauvage que sont les Gentils. En effet, l’Église croit que le Christ, notre paix, a réconcilié par sa croix les Juifs et les Gentils et, en lui-même, a fait des deux un seul.
L’Église reste également toujours attentive aux paroles de l’apôtre Paul au sujet de ceux de sa race : ‘À eux appartiennent l’adoption filiale, la gloire, l’alliance, la Loi, le culte, les promesses ainsi que les patriarches, et d’eux est issu le Christ selon la chair’ (Rm 9, 4-5), le fils de la Vierge Marie. Elle se souvient aussi que les apôtres, fondements et colonnes de l’Église, ainsi qu’un grand nombre des premiers disciples qui annoncèrent l’Évangile du Christ au monde, sont nés du peuple juif.
Selon le témoignage de l’Écriture sainte, Jérusalem n’a pas reconnu le temps où elle fut visitée, et les Juifs, en grande partie, n’acceptèrent pas l’Évangile, et même assez nombreux furent ceux qui s’opposèrent à sa diffusion. Néanmoins, selon l’apôtre, les Juifs restent encore, à cause de leurs pères, très chers à Dieu, dont les dons et l’appel sont sans repentance. Avec les prophètes et le même apôtre, l’Église attend le jour connu de Dieu seul, où tous les peuples invoqueront le Seigneur d’une seule voix et « le serviront sous un même joug ».
Puisque donc le patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux Juifs est si important, le saint Concile veut favoriser et recommander la connaissance et l’estime mutuelles, qui résulteront surtout d’études bibliques et théologiques ainsi que d’un dialogue fraternel.
Même si les autorités juives, avec leurs partisans, ont poussé à la mort du Christ, ce qui s’est commis durant la passion ne peut toutefois être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivants alors, ni aux Juifs d’aujourd’hui. Bien que l’Église soit le nouveau Peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas cependant être présentés ni comme réprouvés par Dieu, ni comme maudits, comme si cela découlait de l’Écriture. C’est pourquoi tous prendront soin de ne rien enseigner dans la catéchèse et la prédication de la Parole de Dieu, qui ne soit conforme à la vérité de l’Évangile et à l’esprit du Christ.
En outre, l’Église qui réprouve toutes les persécutions contre tous les hommes quels qu’ils soient, qui se souvient du patrimoine qu’elle a en commun avec les Juifs et qui est poussée non par des motifs politiques mais la charité religieuse de l’Évangile, déplore les haines, les persécutions, les manifestations d’antisémitisme dirigées contre les Juifs, quels que soient leur époque et leurs auteurs. Au demeurant, comme l’Église l’a toujours tenu et le tient encore, le Christ, dans son immense amour, s’est soumis volontairement à la passion et à la mort à cause des Péchés de tous les hommes, pour que tous obtiennent le salut. Dans sa prédiction, l’Église a donc le devoir d’annoncer la croix du Christ comme signe de l’amour universel de Dieu et comme source de toute grâce »
Vatican II fait un grand pas en avant avec ce document. Est-ce qu’il s’est produit quelque chose de semblable du côté juif ? On a l’impression que non. Quand on parle aujourd’hui d’Israël, on entend le plus souvent moins la religion que l’État hébreu qui s’est créé en grande partie par sa propre force, par des juifs venus de toutes les régions du monde. Ceux-ci en avaient assez, après la Shoah, d’être victimes de non-juifs, de jouer le rôle du « serviteur souffrant » dont parlait déjà le prophète Isaïe. Captivité en Égypte, exil à Babylone, colonisation par les Romains, dispersion en Europe et en Afrique du Nord, émigration aux États-Unis d’Amérique, la Shoah, tout cela vécu avant d’avoir enfin une propre nation souveraine et démocratique. Nous pourrions parler d’un miracle juif dont le fruit s’appelle plus israélien qu’israélite, plus une nation qu’une religion. Le « serviteur souffrant » a fait preuve d’une extraordinaire résilience.
Un autre constat, L’État d’Israël est une société d’immigrés. Ce sont les juifs de la diaspora qui l’ont créé. Considérée par les anciens juifs comme un châtiment de Yahvé, beaucoup de nouveaux voient dans la dispersion plutôt une bénédiction et la possibilité d’une ouverture universelle, sauf chez les orthodoxes fort particularistes.
Selon la philosophe américaine Judith Butler, il est essentiel au juif de vivre parmi et avec le « non-juif », c’est en quelque sorte son ADN. Or cette coexistence se situe de plus en plus au plan séculier, laïc et de moins en moins au plan religieux. Les chrétiens œcuméniques doivent le savoir. Cependant, même l’agnostique Hanna Arendt affirme que la véritable grandeur d’Israël a sa racine dans la foi-confiance qu’il a su avoir en Dieu. Arendt ajoute : dans la mesure où ce peuple remplace la confiance en Dieu par une confiance démesurée en soi, il perd de sa grandeur. Cela est dit dans le contexte d’un sionisme nationaliste, particulariste, qui légitime notamment un comportement discriminatoire et colonialiste des politiciens israéliens envers la minorité palestinienne.
Il y aurait encore quelque chose à dire sur la différence fondamentale entre antisémitisme – que Vatican II lui-même refuse – et l’antisionisme qui s’oppose à une déviation nationaliste du judaïsme, un refus que l’on rencontre même chez de grands philosophes, comme Martin Buber, Emmanuel Levinas, Hanna Arendt, Primo Levi et Judith Butler.
Par cette conférence sur le judaïsme à l’origine du christianisme, nous voulions exprimer une tentative de « recevoir » dans notre christianisme catholique le judaïsme des prophètes, de Jésus et de Saint Paul. C’est de ce judaïsme que nous retrouvons aujourd’hui les traces chez les grands philosophes mentionnés plutôt que chez les politiciens sionistes de l’État d’Israël. C’est lui que représente Judith Butler qui a montré son appartenance à ce groupe avec son livre « Vers la cohabitation » (Paris, Fayard). Dans cet ouvrage, bien qu’il s’agisse avant tout de la coexistence d’un état juif avec un état palestinien, sa philosophie est animée par un universalisme qui a les mêmes racines que l’universalisme chrétien.